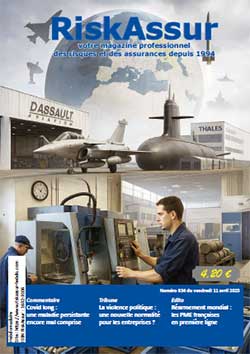|
Il y a, actuellement,
163 internautes qui consultent des articles,
97 808 pages lues aujourd'hui (depuis minuit)
|
La maîtrise du risque climatique
Nous savons, par expérience, que la maîtrise des risques n’est ni sur une science, ni une technique, mais qu’il s’agit plutôt d’une mission, qui consiste à faire accepter des sacrifices, pour protéger des intérêts vitaux, de ceux qui ne croient pas à l’éminence d’un risque, voire à l’existence même d’un danger quelconque.
#
La notion de maitrise du risque déborde de loin le cadre des entreprises où elle est née, pour faire aujourd’hui partie du langage courant de la vie active et notamment dans le secteur public.
#
Pour ce qui est de la maîtrise du risque climatique qui pèse sur notre planète, il s’agit de convaincre près de 200 Etats membres de l’ONU, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, imputables à l'ensemble de leurs activités, auxquelles les scientifiques, à quelques exceptions près, imputent le réchauffement climatique auquel nous assistons.
#
Le monde a pris conscience de l’existence des perturbations climatiques dans les années quatre-vingt, au point de conduire l’ONU, en 1990, à créer le Groupe d’experts intergouvernemental sur le Climat, le GIEC, chargé de recueillir toutes les informations scientifiques publiées sur le sujet et d’en faire régulièrement rapport.
#
De là est née en 1992 à Rio, dans le cadre du Sommet de la terre, la Convention cadre de l’ONU sur le changement climatique, l’instrument destiné à « maîtriser le risque climatique ».
#
La Convention cadre de l’ONU a été ratifiée pratiquement par tous les Etats membres de l’organisation internationale et a donné lieu, dans la foulée, à la mise au point du protocole Kyoto par lequel les nations industrialisées devaient s’engager formellement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le CO2 de 2% par rapport à 1990, pour une période devant se terminer fin 2012.
#
Il s’agissait d’un engagement contraignant qui a fait reculer bon nombre de pays parmi ceux dont on attendait la ratification, et il a fallu la signature de la Russie pour en permettre l’entrée en vigueur en 2007.
#
Notons que les Etats Unis et de l’Australie n’y participent pas.
#
A ce stade l’ONU n’a pas sollicité la participation des pays en voie de développement, dont les principaux comme la Chine, l’Inde, le Brésil et le Mexique qui comptent depuis parmi les principaux pollueurs de la planète, au point que la Chine est maintenant en concurrence avec les Etats-Unis pour la première place.
#
Entre temps, les pays membres de la Convention cadre de l’ONU pour le climat se sont réunis 17 fois, année par année, sans pouvoir se mettre d’accord sur le traité universel destiné à se substituer au protocole de Kyoto.
#
Tous les espoirs se sont portés sur la conférence de Copenhague en 2009, qui s’est soldée par un échec, sauf à exprimer pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, sur la base du rapport du GIEC, à la fin du siècle, confirmé en 2010 par celle de Cancun au Mexique, mais toujours sans s’engager sur les moyens d’y parvenir.
#
D’ailleurs, personne n’ose se demander publiquement, s’il est encore possible d’y parvenir, vu la quantité énorme de CO 2 stocké dans l’atmosphère.
#
Après l’absence d’un résultat déterminant à la conférence suivante qui s'est tenue fin 2010 à Cancun, nous venons d’assister à celle de Durban en Afrique du Sud, ouverte le 28 novembre dernier et qui a failli se terminer le 8 décembre sur un échec.
#
Cependant, les principales délégations encore sur place le 8 au soir, ont poursuivi les négociations pendant les deux jours suivants, pour aboutir le 10 décembre à l’établissement d’une feuille de route commune, ouvrant la voie, avec des objectifs précis, à de futures négociations.
#
Dans la foulée, sous l’impulsion des l’Union européenne, il a été convenu de prolonger le protocole de Kyoto, sans la participation du Canada et du Japon, qui n’ont pas accepté de renouveler leurs engagements.
#
L’adhésion des petits pays, qui attendent une assistance économique importante pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique est acquise, bien que le financement d’un « Fonds vert » destiné à y faire face, est loin d’être assuré, dans la conjoncture financière et économique actuelle.
#
Le calendrier prévoit la mise au point d’un traité en 2015, pour entrer en vigueur en 2020, cette fois-ci avec la totalité de la communauté internationale.
#
Pour obtenir l’adhésion des pays hésitants, dont les pays émergeants, il faut absolument l’accord des Etats-Unis, aujourd’hui bloqué par une majorité politique de climat-septiques, qu’il faut convaincre d’ici-là.
Cliquer ICI pour lire d’autres articles
de la rubrique Edito
|
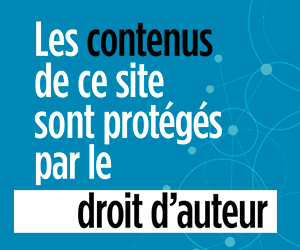 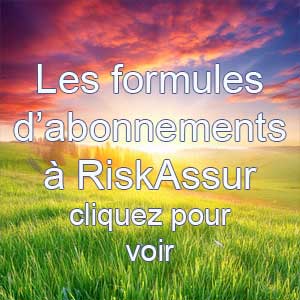 Sommaires de RiskAssur-hebdo
A la une |